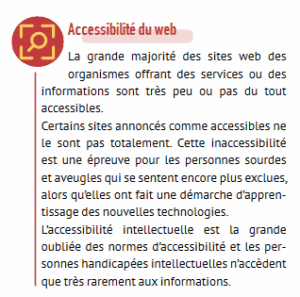Inclusif ou accessible ? Quelle différence ?
« L’accessibilité vise à créer un environnement, un outil ou un service qui puisse être utilisé par une personne en situation de handicap. » (https://www.wefiit.com/blog/concevoir-un-produit-accessible-et-inclusif)
L’inclusivité quant à elle vise à inclure toutes les personnes, qu’elles soient handicapées ou non bien sûr, mais aussi quel que soit leur genre, leur orientation sexuelle, leur origine, leur religion, leur âge ou toute autre discrimination. Et si l’accessibilité numérique est une obligation légale, l’inclusivité ne l’est pas, car on peut tout à fait concevoir des sites adaptés aux enfants ou nécessitant un certain niveau de formation préalable, sans être accusé de discrimination. Le tout est d’être clair sur les textes d’introduction et modes d’emploi. La loi ne se préoccupe que de l’inclusivité des personnes en situation de handicap.
En résumé, l’accessibilité numérique sert à corriger les effets du handicap, et l’inclusivité à prévenir la discrimination. D’un côté, on va trouver des mesures et outils techniques, de l’autre des principes de conception empathiques (ce que certains nomment l’UX design ou conception de l’expérience utilisateur).
Normes et réglementation
Au niveau mondial
- 1948 : La Déclaration universelle des droits de l’homme, dans son article 19, reconnaît le droit à la communication pour tous :
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Il n’est pas question directement d’accessibilité numérique, mais de droit à l’information.
- 2006 : L’Organisation des Nations Unies (ONU) adopte la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ouverte à la signature le 30 mars 2007. La résolution encourage les gouvernements à promouvoir l’accessibilité, tant physique que numérique, même si ce terme n’est pas encore employé (le texte fait alors référence aux fameuses TIC, technologies de l’information et de la communication) :

Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales.
La convention a été ratifiée par l’UE et ses États membres. Le guide pratique pour la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, publié par la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme) insiste sur l’importance de l’accessibilité du Web :
La grande majorité des sites web des organismes offrant des services ou des informations sont très peu ou pas du tout accessibles. Certains sites annoncés comme accessibles ne le sont pas totalement. Cette inaccessibilité est une épreuve pour les personnes sourdes et aveugles qui se sentent encore plus exclues, alors qu’elles ont fait une démarche d’apprentissage des nouvelles technologies. L’accessibilité intellectuelle est la grande oubliée des normes d’accessibilité et les personnes handicapées intellectuelles n’accèdent que très rarement aux informations.
- L’Organisation internationale du travail (OIT) a publié depuis sa création de multiples rapports sur l’inclusivité des personnes handicapées. Citons, en 2021, le rapport, An inclusive digital economy for people with disabilities (Une économie numérique inclusive pour les personnes handicapées), préparé par le Réseau mondial des entreprises et du handicap (GBDN) de l’OIT et la Fundación ONCE, une ONG espagnole spécialisée dans le handicap. Le rapport met en évidence trois principaux leviers pour créer un marché du travail numérique plus inclusif pour les personnes handicapées :
- garantir l’accessibilité,
- favoriser les compétences numériques,
- promouvoir l’emploi numérique.
En Europe
- 1997 : Le Traité d’Amsterdam contient, à son article 13, une clause explicite de non-discrimination en raison des handicaps qui contribue à la promotion de l’égalité des droits et permet également l’émergence d’une véritable politique européenne du handicap.
- 2000 : La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptée à Nice le 7 décembre, proclame à son article 1er que « la dignité humaine est inviolable. Elle doit être « respectée et protégée » et interdit toute discrimination fondée sur un handicap (article 21, paragraphe 1). De même, elle « reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté » (article 26).
- 2009 : Le traité de Lisbonne attribue la même valeur juridique à la Charte qu’aux traités (article 6 du traité sur l’Union européenne).
- Le Traité relatif au Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) exige de l’Union qu’elle combatte toute discrimination fondée sur un handicap dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions (article 10) et lui confère le pouvoir de légiférer en ce sens (article 19).
Les États membres de l’UE doivent garantir que les sites internet et les applications mobiles des organismes du secteur public sont «plus accessibles», en particulier pour les personnes handicapées, en les rendant «perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes». La norme d’accessibilité est définie dans la norme européenne harmonisée EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). Les parties de cette norme qui sont pertinentes pour la directive sont énumérées à l’annexe A de la norme.
Les organismes du secteur public doivent régulièrement fournir une déclaration d’accessibilité détaillée, complète et claire sur la façon dont leurs sites internet et leurs applications mobiles se conforment à la directive.
- 2019 : Acte européen sur l’accessibilité (EAA). Les produits et services couverts s’étendent bien au delà de l’accès Internet et couvrent « les produits et services qui ont été reconnus comme les plus importants pour les personnes handicapées » :
- ordinateurs et systèmes d’exploitation,
- distributeurs automatiques de billets, distributeurs de titres de transport et les bornes d’enregistrement automatiques,
- smartphones,
- équipements de télévision reliés à des services de télévision numériques,
- services de téléphonie et équipements connexes,
- accès à des services de médias audiovisuels, tels que les émissions télévisées et les équipements grand public correspondants,
- services liés au transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation intérieure et par autobus de passagers,
- services bancaires,
- livres électroniques,
- commerce électronique.
- Les États membres doivent transposer cette loi dans leur législation nationale. Tous sont loin de l’avoir fait…
En France
- 1999 : Première avancée via la circulaire du 7 octobre 1999 relative aux sites internet des services et des établissements publics de l’État
Les responsables des sites veilleront tout particulièrement à favoriser l’accessibilité de l’information à tous les internautes, notamment les personnes handicapées, non voyantes, malvoyantes ou malentendantes. … Ils pourront utilement se référer aux recommandations de niveau 1 du World Wide Web Consortium consacrées à l’accessibilité des contenus sur la Toile, qui sont disponibles en français à la même adresse.
- 2005 : la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, formule l’exigence d’accessibilité numérique des services publics dans son article 47 :
Les services de communication publique en ligne des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. L’accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.
- 2018 : L’article 47 de la loi du 11 février 2005 est modifié par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Certaines entreprises de droit privé sont désormais également soumises à l’obligation d’accessibilité.
- 2023 : L’arrêté du 9 octobre 2023 fixe les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services :
Les produits sont conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées et sont accompagnés d’informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d’accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur le produit. (article Ier)
On ne peut que recommander à chacun de prendre connaissance de cet arrêté. L’utilisation d’un produit ou service devrait rester possible que ce soit en l’absence de vision, en cas de vision limitée, en l’absence de perception des couleurs, en l’absence d’audition ou en cas d’audition limitée, en l’absence de capacité vocale, en cas de manipulation ou de force limitée ou encore en cas d’amplitude de mouvements limitée, et de capacités cognitives limitées. La date de mise en application de cet arrêté est fixée au 28 juin 2025.
Et n’oublions pas que l’amélioration de l’accessibilité ne profite pas aux seuls handicapés, comme certains ont tendance à le croire, mais bien à chacun de nous. Les exemples d’améliorations inclusives sont nombreux depuis l’invention des bateaux permettant l’accès tant aux fauteuils roulants qu’aux poussettes de bébé et valises à roulettes.
Au-delà des bénéfices atteints pour les utilisateurs handicapés, l’accessibilité web profite plus largement à tous les utilisateurs et acteurs, notamment en ce qui concerne l’utilisabilité, la maîtrise de la production des contenus, les retours sur investissement et d’image. (extrait de l’article Wikipedia accessibilité du Web)
Zoom sur les normes
Normes internationales
- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), publiés par l’Organisation pour la standardisation de l’information et de la communication (ISO). Ces normes présentent les méthodes pour rendre les sites Internet accessibles à tous, en considérant les aspects physiques, psychologiques et techniques des utilisateurs. Leur première version (1.0) date de 1999. La version 2.2 est publiée par l’ISO en tant que norme ISO/IEC 40500:2012. La version 3.0 est actuellement en développement.
- ISO/IEC 30071-1 — Code de bonnes pratiques pour créer des produits et des services TIC accessibles.
Normes européennes
- EN 301 549 – Exigences d’accessibilité pour les produits et services ICT – Cette norme, référencée par la directive européenne sur l’accessibilité numérique, couvre les applications Web et mobiles, et aborde aussi de nombreuses autres technologies au-delà de celles couvertes par les WCAG : documents bureautiques, logiciels et systèmes d’exploitation.
Référentiel français
- Le RGAA, actuellement dans sa version 4, couvre les exigences des WCAG en présentant à la fois les critères de conformité et la méthode de test. Il ne traite donc que l’accessibilité des sites Web et pas l’intégralité des exigences de l’acte européen d’accessibilité.
Vous l’aurez remarqué, les textes et grandes déclarations ne manquent pas. Leur mise en œuvre est plus aléatoire et se fait encore attendre. « Il y a tellement d’autres priorités ».
Journée A11Y 2024 – L’occasion de faire le point sur l’application des lois et des réglementations
 Les journées A11Y Paris 2024 sur l’accessibilité numérique se sont tenues le 25 juin et le 26 juin.
Les journées A11Y Paris 2024 sur l’accessibilité numérique se sont tenues le 25 juin et le 26 juin.
J’ai pu assister à la journée du 25 juin qui se tenait dans le cadre impressionnant du studio 104 de la maison de la Radio et de la Musique.
La mise en œuvre et l’application de la réglementation européenne dans la pratique étaient à l’ordre du jour.
La représentante de l’ARCOM, chargée du contrôle de l’application de la réglementation dans les établissements publics depuis septembre 2023, nous expliqua sa démarche très pragmatique, compte tenu du peu de moyens alloués, en tout et pour tout 2,5 collaborateurs, pour effectuer les contrôles et prêcher la bonne parole. Le nombre de sites publics conformes à la réglementation ne dépasserait pas 3%.
Difficile dans ces conditions de traiter les signalements reçus des associations et particuliers. Se pose également la question de garantie de confidentialité des lanceurs d’alerte, supposant l’anonymisation des personnes qui portent plainte. Le développement d’un outil de contrôle automatisé des sites est en cours, mais l’on sait déjà que l’automatisation ne peut couvrir l’intégralité des contrôles (30% des contrôles pourraient être effectués avec ChatGPT). Un outil de ce type est utilisé en Belgique pour le contrôle des sites gouvernementaux.
L’avenir du RGAA a été également largement discuté : comment le rendre conforme à l’ensemble des exigences de l’acte européen ? Le représentant de la DINUM, en charge de l’évolution du RGAA, a confirmé qu’aucune évolution n’était actuellement en chantier : « On bouge pas parce que c’est du boulot »(sic). D’autres pays, tel le Grand-Duché du Luxembourg, ont été plus proactifs et ont créé une version étendue du RGAA, intégrant la conformité des applications mobiles et bureautiques : RAWEB. Aux 106 critères initiaux s’ajoutent désormais, dans le nouveau référentiel RAWeb, 30 critères qui permettent de répondre à l’intégralité de la norme européenne (voir mémoire les moyens de l’accessibilité numérique).
Pour aller plus loin
Vous pouvez consulter en ligne les résumés de ces journées par les professionnels de l’accessibilité :
ainsi que les nombreuses ressources existantes sur l’accessibilité numérique :
- cours fun-mooc sur l’accessibilité numérique
- web-accessibility/the-world-wide-web-consortium-w3c-introduction-to-web-accessibility
- Ressources sur l’accessibilité en français sur le site du W3C
Conclusion
On ne saurait conclure cet article sans faire référence aux Jeux paralympiques 2024 qui véhiculent un message puissant sur l’inclusivité et la nécessité de faire progresser l’accessibilité, qu’elle soit physique ou numérique.
En résumé, que vous soyez « officiellement » handicapé ou non, une meilleure accessibilité des outils numériques ne pourait que faciliter votre usage de ces outils : vidéos sous-titrées, plans de sites, contrastes et tailles de caractères suffisantes ne sont pas un luxe !